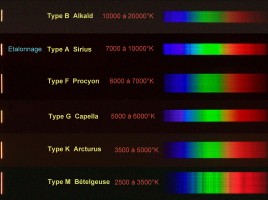L’image du mois de mars 2016 : la constellation d’Orion
Pour le mois de mars 2016, nous vous proposons la photographie « classique » de la constellation d’Orion, une image réalisable avec un minimum de matériel, à savoir un appareil photographique numérique (APN) réflex ou bridge muni d’un objectif grand angulaire, monté, soit sur un pied motorisé permettant de faire des poses …